Retrouvez aussi les enregistrements des Visiteurs du Soir en podcasts ! Disponible sur : AntennaPod, Apple Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Podcast Addict, Spotify, Tune In...
Comment penser et présenter la littérature pour la jeunesse ?
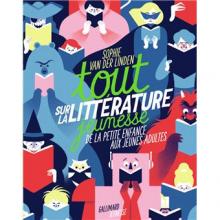 Par Sophie Van der Linden, spécialiste de l'album et formatrice.
Par Sophie Van der Linden, spécialiste de l'album et formatrice.
(Conférence du 8 octobre 2021)
Les termes de littérature jeunesse sont assez récents au regard de l’histoire même de cette production. Comment le terme de « littérature » est-il réfléchi dans ce secteur ? D’ailleurs, l’est-il seulement ? Entre les deux pôles de l’éducation et du divertissement, existe-t-il une troisième voie pour la littérature jeunesse ? Sophie Van der Linden, auteure de Tout sur la littérature jeunesse (Gallimard Jeunesse, mai 2021), poursuivra ces questionnements et présentera sa démarche, celle d’une publication généraliste dédiée à la littérature pour la jeunesse.
150 ans de livres photo-illustrés pour enfants
Conférence en ligne de Laurence Le Guen (Université Rennes 2) - 16 avril 2021
Dès la fin du XIXe siècle, à la faveur des développements techniques qui ont facilité l’impression de ce type d’image, la photographie s’est taillée une place de choix dans les livres pour enfants et les ouvrages photographiques se sont multipliés, des abécédaires aux documentaires en passant par les contes de fées, les livres de voyages, les novellisations de films .et les livres d’artistes.
Bien que ces livres aient pourtant marqué plusieurs générations et façonné bien des regards, cette littérature photographique demeure largement méconnue, à quelques notables exceptions près. Elle a souffert du double désintérêt longtemps associé, d’une part à la photographie, d’autre part à la littérature de jeunesse.
La conférence 150 ans de livres photo-illustrés invitera donc le public à circuler à travers les pages de ce qu’il est désormais convenu d’appeler la photolittérature pour la jeunesse et permettra de prendre connaissance de la grande variété de cette production, tout au long de son histoire et dans la diversité de ses principales facettes.
Adolescences et dystopies
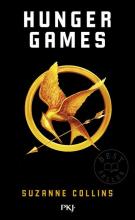 (Conférence de Laurent Bazin, Université Paris-Saclay - 22 février 2019)
(Conférence de Laurent Bazin, Université Paris-Saclay - 22 février 2019)
Si la fin du XXè siècle marquait pour la jeunesse une passion pour la fantasy dans la foulée du succès de Harry Potter, le XXIè a vu l’apparition d’une fascination plus grande encore pour les univers dystopiques (Hunger Games, Divergente, Labyrinthe….) devenus, et de très loin, le genre dominant dans les pratiques de consommation culturelle des adolescents et jeunes adultes. Quelles sont les œuvres les plus représentatives de cette vogue éditoriale ? Quels en sont les thèmes, préoccupations et enjeux principaux ? Comment ces best-sellers se redéployent-ils sous d’autres formes médiatiques (films, jeux vidéo, métavers) ? La dystopie pour jeunes publics est-elle une spécificité du Troisième Millénaire ou s’inscrit-elle dans une histoire ? Et surtout : comment interpréter son succès et que nous disent toutes ces fictions de l’imaginaire collectif des jeunes générations ?
Les albums adressés aux plus jeunes, de Pierre l'ébouriffé à Lou et Mouf
 Par Evelyne Resmond-Wenz, coordinatrice de l'association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) Armor, formatrice et lectrice auprès d'enfants et de leurs parents
Par Evelyne Resmond-Wenz, coordinatrice de l'association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations) Armor, formatrice et lectrice auprès d'enfants et de leurs parents
(conférence du 17 mars 2017)
Au début des années 1980, le slogan d'ACCES, « Les livres, c'est bon pour les bébés », imaginé par Marie Bonnafé, confortait celui de Dorothy Buttler « Babies need books » mais dérangeait encore de nombreux adultes. Depuis, les représentations ont rapidement évolué et l'offre de livres pour les jeunes enfants s'est considérablement développée. Pourtant, des livres à partager avec les tout petits existaient depuis longtemps. Du Struwwelpeter, imaginé en 1844 par le docteur Hoffman, pour les trois ans de son fils, aux livres de Jeanne Ashbé, basés sur l'observation des tout-petits, quelles ont été et quelles sont aujourd'hui les évolutions des albums « premier âge »? Quelle a été l'influence des précurseurs sur les créations d'aujourd'hui ?
(1ère partie)
(2è partie)
Le jeu vidéo raconte-t-il des histoires ?
 par Vincent Berry, enseignant-chercheur à l'université Paris 13
par Vincent Berry, enseignant-chercheur à l'université Paris 13
(conférence du 18 novembre 2016)
Apparu dans les années 1960 sur des campus universitaires américains, le jeu vidéo est devenu, en l'espace de 50 ans, l'une des plus importantes industries culturelles du monde. Son histoire est aujourd'hui bien connue. Nombre d'ouvrages y sont consacrés, présentant l'évolution des machines, retraçant l'apparition des titres « cultes » et célébrant les figures héroïques de ses inventeurs. A y regarder de près, le jeu vidéo s'inscrit cependant dans une histoire bien plus ancienne : celle du jeu, du jouet et de la littérature. En effet, si le jeu vidéo est souvent pensé dans une radicale nouveauté, une mise en perspective avec d'autres objets permet de voir que les jeux vidéo sont porteurs de structures, d'expériences et de significations plus anciennes. De Barbie à Lara Croft, de Oui-Oui à Adibou, de Popeye à Mario, des maisons de poupées.
(1ère partie)
(2è partie)
Figures de la fiction : texte, image, illustration dans le roman au XVIIIe siècle
 par Benoît Tane, Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès
par Benoît Tane, Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès
(conférence du 22 avril 2016)
Celui qui ouvre un livre « avec figures » est prévenu. Ce lecteur est aussi spectateur. Il l'est parfois avant tout et s'attardera sur un frontispice, au seuil d'un volume. Il l'est peut-être surtout et cherchera des images dispersées. Qui sait même s'il lira le livre, fût-ce un roman ? Et qui dit que ces images seront contemplées durablement ? On voudrait rendre compte ici de cette précarité et de cette intimité : le plaisir du lecteur-spectateur des romans illustrés du XVIIIe siècle n'est pas un simple « plaisir du texte » : c'est un plaisir du livre, comme dispositif qui fait travailler l'imaginaire.
(1ère partie)
(2è partie)
La fantasy pour la jeunesse : une histoire sans fin ?
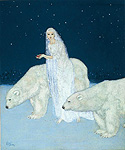 La fantasy pour la jeunesse : une histoire sans fin ?
La fantasy pour la jeunesse : une histoire sans fin ?
par Anne Besson, maître de conférences en Littérature générale et comparée, Université d'Artois (Arras)
(conférence du 2 octobre 2015)
La vogue actuelle de la fantasy pour la jeunesse, qui investit, voire envahit, les différents supports médiatiques destinés aux enfants et adolescents, a pris l'ampleur d'un phénomène qui, plus de quinze ans après les premiers succès de Philip Pullman et J.K. Rowling, semble susciter toujours autant de passion chez les jeunes lecteurs, et de propositions en réponse à ces attentes de la part des créateurs.
Un tel retour contemporain à l'imaginaire merveilleux et aux prestiges magiques de l'enfance mérite que la réflexion s'y arrête : présente dès les origines de la fantasy comme genre littéraire dans l'Angleterre victorienne, la production spécifiquement destinée aux plus jeunes possède en effet son histoire, ses spécificités, son évolution qui mène jusqu'à sa florissante situation d'aujourd'hui. C'est le rapport d'une époque, et de son genre fictionnel privilégié, avec l'image mythifiée qu'ils se font de l'enfance qui doit dès lors se voir questionné.
(1ère partie)
(2è partie)
Le graphiste et l'enfant : panorama international
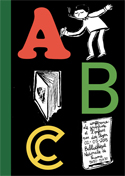 par Loïc Boyer, graphiste, designer graphique, directeur de collection aux éditions Didier Jeunesse
par Loïc Boyer, graphiste, designer graphique, directeur de collection aux éditions Didier Jeunesse
(conférence du 22 mai 2015)
En France, au Japon, en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Italie, partout où le secteur de l'édition pour la jeunesse s'est trouvé foisonnant et où il y a eu une production de design graphique conséquente, il y a eu des graphistes pour investir l'album. À travers l'approche biographique de quelques-uns d'entre eux, il s'est agi d'étudier les circonstances qui ont pu amener ces spécialistes de la typographie, de la presse, de la publicité, à œuvrer pour les enfants. Quelles furent leur empreinte, leur approche formelle et/ou éditoriale ? Ces deux activités ont-elles noué des relations spécifiques ?
(1ère partie)
(2è partie)
La matière à l'oeuvre en littérature de jeunesse
 par Anne Chassagnol, maître de conférences au département d'Etudes des Pays Anglophones de l'Université Paris 8.
par Anne Chassagnol, maître de conférences au département d'Etudes des Pays Anglophones de l'Université Paris 8.
(conférence du 13 mars 2015)
L'histoire de la littérature de jeunesse, au-delà de la dichotomie texte-image, peut être explorée sous l'angle de la matière. Par matière, on entend aussi bien le choix du grammage, les mécanismes, les volvelles et les rabats que les feuilles de rhodoïdes ou les pliages. Quelle place faut-il donc accorder à la matérialité? Que faire de cette littérature qui demande à ses lecteurs de faire et défaire plutôt que de lire ? Cette présentation sera composée d'un volet historique avant de se focaliser sur des études de cas plus contemporains.
(1ère partie)
(2è partie)
Du Petit Prince à World of Warcraft : statut et fonction du livre dans les univers transmédiatiques pour la jeunesse
 par Antoine Dauphragne, docteur en Sciences de l'éducation et chargé de recherches au sein du laboratoire Experice, Université Paris 13
par Antoine Dauphragne, docteur en Sciences de l'éducation et chargé de recherches au sein du laboratoire Experice, Université Paris 13
(conférence du 22 février 2013)
La culture enfantine contemporaine est souvent caractérisée par sa dimension transmédiatique, c'est-à-dire par sa capacité à mobiliser différents supports médiatiques (films, dessins animés, romans, bandes dessinées, jeux et jouets, etc.) pour développer un même univers de fiction. À cet égard, des références aussi hétérogènes que Le Petit Prince, Babar, Tintin, Harry Potter, Star Wars ou World of Warcraft sont traversées par des dynamiques fictionnelles, commerciales et éditoriales communes. Quelle est la place du livre dans ces grands ensembles transmédiatiques ? Comment œuvres patrimoniales et univers de la culture de masse utilisent le livre et l'articulent à d'autres médias.
(1ère partie)
(2è partie)
Un siècle de romans scouts
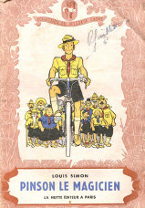 par Laurent Déom, maître de conférences à l'université Charles de Gaulle - Lille 3
par Laurent Déom, maître de conférences à l'université Charles de Gaulle - Lille 3
1913-2013 : le roman scout en français est plus que centenaire. C'est l'occasion de faire le point sur ce genre littéraire souvent mal connu : quels en sont les traits essentiels, les tendances majeures, les auteurs représentatifs et les œuvres archétypales, quelles vicissitudes a-t-il rencontrées depuis 1913, avec quelles constantes et quelles mutations ?
Conférence du 14 décembre 2012. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
Jalons pour une culture audiovisuelle jeunesse en France XIXe-XXe siècles
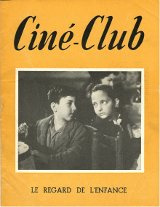 par Valérie Vignaux, historienne du cinéma français, maître de conférences habilitée à diriger les recherches en études cinématographiques à l'université François-Rabelais de Tours et membre de l'équipe de recherche INTRU (Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturels)
par Valérie Vignaux, historienne du cinéma français, maître de conférences habilitée à diriger les recherches en études cinématographiques à l'université François-Rabelais de Tours et membre de l'équipe de recherche INTRU (Interactions, transferts, ruptures artistiques et culturels)
Si la littérature de jeunesse est aujourd'hui un champ disciplinaire structuré et dynamique, il n'en est pas de même du cinéma de jeunesse pour lequel les recherches sont rares, les seuls ouvrages consacrés à la question n'évoquant en général que les représentations de l'enfance à l'écran. En suivant la définition proposée par Pascal Ory, de l'histoire culturelle comme une histoire sociale des représentations, il s'agit de retracer le cadre institutionnel ou industriel dans lequel les objets culturels cinématographiques destinés à l'enfance se sont développés au cours du vingtième siècle - de 1895, date des débuts du cinéma, aux années soixante, moment où en raison d'un accès facilité aux images mouvantes, avec la télévision bien sûr, les modèles et les œuvres se transforment.
Conférence du 13 avril 2012. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
1ère partie :
2ème partie :
Panorama de la tradition féerique britannique : innovations et réinventions
 par Anne Chassagnol, maître de conférences, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
par Anne Chassagnol, maître de conférences, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
L’iconographie féerique est-elle la même d’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre ? La fée française a-t-elle les mêmes pouvoirs, les mêmes atouts que son homologue britannique ? Comment expliquer ces différences ?
En reprennant les grandes lignes de l’histoire de la féerie britannique à travers William Shakespeare, Edmund Spenser, ou William Blake, on comprend comment les fées ont pu finalement s’imposer et se réinventer au XIXe siècle dans un grand nombre de territoires comme la littérature, le théâtre, l’opéra, la peinture, le ballet, mais également la science, pour définir un folklore aussi caractéristique que prégnant. La question de l'influence des fées victoriennes sur la culture contemporaine de Philippe Pullman à Terry Pratchett, en passant par Diana Wynne Jones, Neil Gaiman, ou Eoin Colfer clôturait cette intervention.
Conférence du 16 mars 2012. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
1ère partie :
2ème partie :
Du roman pédagogique à l'aventure romanesque, 1860-1920

par Matthieu Letourneux, maître de conférences en littérature, Université Paris Ouest - Nanterre La Défense
Au cours du XIXe siècle, la littérature pour la jeunesse a progressivement évolué d’un modèle de contes édifiants vers un modèle dominé par l’aventure et le dépaysement. Les petits saints ont laissé la place aux aventuriers, l’amour de Dieu à l’affirmation de la toute-puissance du héros. Ce qui change plus fondamentalement, c’est que les œuvres pour la jeunesse glissent d’une méfiance à l’égard de la fiction et de la littérature en général, vers la reconnaissance progressive des logiques et des imaginaires romanesques, autrement dit, qu’elles acceptent la fiction sous toutes ses formes, y compris les plus délégitimées. Or, loin d’aller de soi, un tel glissement est le produit de toute une série de mutations : transformations politiques, passage de relais des éditeurs catholiques de province vers les laïcs parisiens, mutations des visées éducatives et du rôle attribué au livre de jeunesse, évolution enfin du paysage du livre, entraînant de nouveaux usages de la lecture. Mais si les causes sont nombreuses, le bouleversement qu’elles ont engendré a marqué durablement la littérature pour la jeunesse, et en explique aujourd’hui encore certaines des contradictions.
Conférence du 16 décembre 2011. Attention, cette conférence ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
1ère partie :
2ème partie :
L'abécédaire : du livre d'éducation à l'album récréatif, généalogie et poétique d'un genre fondateur
par Marie-Pierre Litaudon, Université de Rennes II
Premier livre de l’enfance, l’abécédaire l’est à plus d’un titre. D’une part parce qu’il est le plus ancien genre destiné à cet âge, mais aussi, parce que la tradition l’a consacré « livre des livres », clé du savoir écrit et premier principe d’éducation. Au cours des siècles l’abécédaire s’est transformé, tant dans son contenu que dans sa présentation, tant dans l’identité de ses destinataires que dans ses modalités d’usage, signes de l’évolution des visées éducatives.
Conférence du 12 décembre 2008. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
1ère partie :
2ème partie :
D'Alice à Harry : la tradition de la fantasy anglaise et son influence sur le roman contemporain
par Virginie Douglas, professeur agrégé, Université de Rouen
Après quelques rappels théoriques permettant de distinguer les notions de merveilleux, de fantastique et de science fiction et de repérer les caractéristiques de la fantasy, l’on verra comment les origines de la littérature britannique pour la jeunesse sont marquées par l’influence du conte, pour aboutir dès le XIXe siècle à l’épanouissement de cette catégorie typiquement anglaise qu’est la fantasy, avec des auteurs comme Lewis Carroll ou Walter Kingsley.
Conférence du 20 juin 2008. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
1ère partie :
2ème partie :
La robinsonnade pour la jeunesse, du XIXe siècle à nos jours : la question de la découverte de l'altérité
 par Danielle Dubois-Marcoin, maître de conférences à l'Université d'Artois
par Danielle Dubois-Marcoin, maître de conférences à l'Université d'Artois
Le texte source de Daniel Defoe, Robinson Crusoé, (1719) met en scène et interroge la rencontre du « civilisé », autrement dit l’homme occidental, et du « Naturel », dans le cadre de l’aventure en solitaire du naufragé sur une île déserte.
Cette rencontre peut être considérée comme un motif constitutif de la robinsonnade, un genre littéraire qui va se développer dès la fin du XVIIIe siècle au profit de la jeunesse.
Conférence du 25 janvier 2008. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.
L'album contemporain pour la jeunesse depuis les années 50
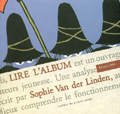 par Sophie Van der Linden, directrice de l'Institut international Charles Perrault
par Sophie Van der Linden, directrice de l'Institut international Charles Perrault
L’album contemporain français montre une étonnante diversité, qu’il s’agisse des techniques, des styles, des modes narratifs ou des mises en pages. Au regard des productions émanant des autres pays, il semble que l’album français se singularise par sa créativité et sa singularité. Quels sont les grands moments de ses évolutions ? Quels en sont les acteurs, les livres phares ? En quoi ont-ils infléchi le développement de l’album ?
Un parcours, en quelques repères, des années 1950 à nos jours, tente de montrer les spécificités françaises de cette forme éditoriale.
Conférence du 27 avril 2007. Attention, cette rencontre ayant été enregistrée "avec les moyens du bord", les conditions d'écoute ne seront pas forcément optimales. Toutes nos excuses pour ce désagrément.



